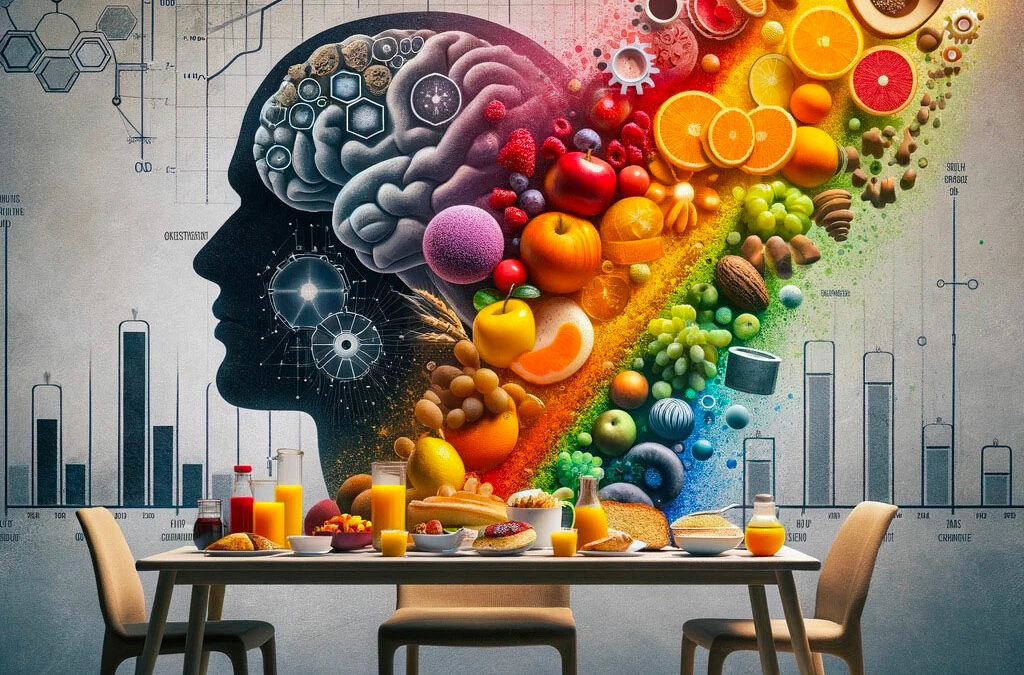La Saison des Allergies
Impact des allergies respiratoires sur la ventilation nasale et la croissance maxillo-faciale Mécanismes physiopathologiques, conséquences morphologiques et prise en charge orthodontique
Introduction 🌺
Les allergies respiratoires 🤧, définies comme des réactions d’hypersensibilité inappropriées et excessives du système immunitaire à des substances inoffensives présentes dans l’air, représentent un problème majeur de santé publique avec une prévalence en constante augmentation au cours des dernières décennies[1]. La rhinite allergique, inflammation de la muqueuse nasale secondaire à une allergie, touche plus de 400 millions de personnes dans le monde, avec des variations géographiques importantes. Les aéroallergènes les plus fréquemment impliqués sont les pollens de graminées, d’arbres et d’herbacées 🌼, les acariens 🕷️, les moisissures 🍄 et les squames d’animaux 🐈.
Chez les sujets allergiques, l’exposition répétée aux allergènes respiratoires déclenche une réaction inflammatoire chronique de la muqueuse nasale médiée par les IgE, entraînant une obstruction nasale persistante par hypertrophie des cornets et hypersécrétion de mucus[1]. Cette obstruction nasale chronique peut avoir des conséquences délétères sur la croissance maxillo-faciale chez l’enfant 👶, en modifiant l’équilibre des forces s’exerçant sur les maxillaires pendant la croissance. Des dysmorphoses caractéristiques sont fréquemment observées, comme l’insuffisance transversale du maxillaire, la béance antérieure ou la rétrognathie mandibulaire.
Une prise en charge précoce et pluridisciplinaire est essentielle pour prévenir l’évolution défavorable de ces dysmorphoses et optimiser la croissance faciale. Le traitement étiologique par éviction allergénique et immunothérapie spécifique permet de contrôler l’inflammation nasale, tandis que le traitement symptomatique par corticoïdes nasaux et antihistaminiques soulage l’obstruction. En complément, un traitement orthodontique adapté à l’âge et à la sévérité des troubles est souvent nécessaire pour corriger les dysmorphoses installées et guider la croissance des maxillaires.
L’objectif de cette revue de la littérature est de faire le point sur les données actuelles concernant les mécanismes physiopathologiques de l’allergie respiratoire, ses répercussions sur la ventilation nasale et la croissance maxillo-faciale, et les principes de traitement en orthopédie dento-faciale. Les recommandations diététiques pour limiter l’inflammation seront également abordées.
Méthodes 🔍
Une recherche bibliographique a été réalisée sur les bases de données PubMed, ScienceDirect et Google Scholar en utilisant les mots-clés suivants : « allergic rhinitis », « nasal obstruction », « mouth breathing », « maxillofacial growth », « malocclusion », « orthodontic treatment », « anti-inflammatory diet ». Seuls les articles en anglais publiés au cours des 20 dernières années dans des revues à comité de lecture ont été inclus. Les références bibliographiques des articles sélectionnés ont été analysées pour identifier des études supplémentaires pertinentes. Au total, 86 articles ont été retenus et analysés en détail.
Résultats 📊
1. Mécanismes physiopathologiques de l’allergie respiratoire 🔬
L’allergie respiratoire est une réaction d’hypersensibilité de type I médiée par les IgE, faisant intervenir différents types cellulaires et médiateurs pro-inflammatoires[1] :
Sensibilisation : Lors d’un premier contact avec l’allergène, les cellules présentatrices d’antigène (CPA) comme les cellules dendritiques captent l’allergène, l’apprêtent et le présentent aux lymphocytes T CD4+ naïfs qui se différencient en lymphocytes Th2. Ceux-ci activent les lymphocytes B spécifiques de l’allergène qui subissent une commutation isotypique vers la production d’IgE. Les IgE spécifiques se fixent sur les récepteurs de haute affinité (FcεRI) à la surface des mastocytes tissulaires et des basophiles circulants.
Réaction allergique précoce : Lors des expositions ultérieures à l’allergène, la liaison de l’allergène aux IgE spécifiques entraîne l’agrégation des FcεRI et active les mastocytes et les basophiles. Ceux-ci libèrent rapidement (en quelques minutes) des médiateurs préformés comme l’histamine et des médiateurs néoformés comme les leucotriènes et les prostaglandines. L’histamine, en se liant aux récepteurs H1 exprimés par les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses, provoque une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité vasculaire et une bronchoconstriction. Les leucotriènes et les prostaglandines amplifient ces effets et stimulent la sécrétion de mucus par les glandes séro-muqueuses.
Réaction allergique tardive : Quatre à six heures après l’exposition allergénique, une seconde phase inflammatoire se met en place, caractérisée par un afflux de cellules inflammatoires (éosinophiles, basophiles, lymphocytes Th2) au site de la réaction. Les éosinophiles libèrent des protéines cationiques toxiques (ECP, MBP) et des radicaux libres qui endommagent l’épithélium respiratoire. Ils produisent également des cytokines pro-inflammatoires (IL-3, IL-5, GM-CSF) qui entretiennent l’inflammation. Les lymphocytes Th2 sécrètent des cytokines (IL-4, IL-5, IL-13) qui favorisent la production d’IgE, le recrutement et l’activation des éosinophiles et la production de mucus.
Inflammation chronique : L’exposition répétée aux allergènes respiratoires pendant la saison pollinique entretient une inflammation chronique de la muqueuse nasale et bronchique. Cette inflammation persistante est responsable des symptômes chroniques (obstruction nasale, hyperréactivité bronchique) et des dommages tissulaires à long terme (remodelage des voies aériennes)[1].
2. Conséquences sur la ventilation nasale et la croissance maxillo-faciale 👃📏
L’inflammation chronique de la muqueuse nasale secondaire à l’allergie respiratoire entraîne une obstruction nasale persistante par différents mécanismes[1] :
Congestion vasculaire : La vasodilatation et l’augmentation de la perméabilité capillaire induites par les médiateurs pro-inflammatoires (histamine, leucotriènes, prostaglandines) entraînent un œdème de la muqueuse nasale et une hypertrophie des cornets, réduisant le calibre des fosses nasales.
Hypersécrétion de mucus : L’hyperplasie et l’hypersécrétion des glandes séro-muqueuses stimulées par les médiateurs inflammatoires (histamine, prostaglandines, acétylcholine) augmentent la quantité et la viscosité des sécrétions nasales, obstruant les voies aériennes.
Hypertrophie adénoïdienne : L’inflammation chronique des végétations adénoïdes (tissu lymphoïde du nasopharynx) favorise leur hypertrophie, pouvant obstruer les choanes et gêner la ventilation nasale.
Cette obstruction nasale chronique, lorsqu’elle survient pendant la croissance, peut avoir des conséquences majeures sur le développement du massif facial :
Insuffisance transversale du maxillaire : La respiration buccale induite par l’obstruction nasale entraîne une position basse de la langue qui ne stimule plus la croissance transversale du maxillaire. La pression des joues n’est plus contrebalancée par la pression linguale, ce qui limite la croissance en largeur du maxillaire et donne un palais étroit et profond (palais ogival).
Béance antérieure : L’interposition de la langue entre les arcades dentaires pour faciliter la respiration buccale peut entraîner une béance antérieure (absence de contact entre les incisives supérieures et inférieures lors de la fermeture buccale). La supraclusion incisive (recouvrement vertical excessif) est également fréquente.
Rétrognathie mandibulaire : La position basse et antérieure de la langue ne stimule plus la croissance sagittale de la mandibule, qui tend à se rétracter par rapport au maxillaire. La mandibule pivote vers le bas et l’arrière, augmentant la divergence faciale et la hauteur de l’étage inférieur de la face.
Incompétence labiale et étirement de la lèvre supérieure : La respiration buccale permanente entraîne une position entrouverte des lèvres au repos, avec un étirement de la lèvre supérieure qui se retrousse, exposant les incisives supérieures.
Ces dysmorphoses maxillo-faciales peuvent avoir des répercussions esthétiques, fonctionnelles et psychologiques importantes, altérant la qualité de vie des patients. Elles sont souvent associées à des troubles de la ventilation (ronflements, apnées du sommeil), de la mastication et de la phonation. Sur le plan esthétique, elles donnent un faciès adénoïdien caractéristique avec un visage long et étroit, un profil convexe et des cernes sous les yeux.
3. Prise en charge orthodontique des dysmorphoses liées à l’allergie 🦷
Le traitement orthodontique des dysmorphoses maxillo-faciales secondaires à l’allergie respiratoire doit être adapté à l’âge du patient, à la sévérité des troubles et à l’état de maturation des sutures maxillaires. Il fait appel à différentes techniques en fonction des objectifs thérapeutiques :
Traitement interceptif précoce : Chez l’enfant en denture temporaire ou mixte, des appareils fonctionnels comme l’activateur de Klammt ou le Nite-Guide peuvent être utilisés pour stimuler la croissance mandibulaire et corriger la supraclusion. Ils agissent en modifiant la posture de la langue et en transmettant des forces aux maxillaires par l’intermédiaire des muscles oro-faciaux.
Expansion maxillaire : En cas d’endognathie maxillaire sévère, une expansion transversale du maxillaire peut être réalisée à l’aide d’appareils amovibles à vis (quad-hélix, bi-hélix) ou fixes (disjoncteur à ancrage dentaire ou osseux). L’activation progressive des vis permet d’obtenir une expansion de 0,5 à 1 mm par semaine, corrigeant l’insuffisance transversale et restaurant un volume nasal suffisant.
Disjonction intermaxillaire rapide : Chez l’adolescent en fin de croissance, lorsque les sutures maxillaires sont peu mobiles, une disjonction intermaxillaire rapide chirurgicalement assistée (SARME) peut être indiquée. Elle consiste à réaliser une ostéotomie des murs latéraux du maxillaire et de la suture intermaxillaire, puis à mettre en place un disjoncteur à ancrage osseux activé rapidement (1 à 2 mm par jour). Cette technique permet d’obtenir une expansion maxillaire de 7 à 10 mm en quelques jours, corrigeant efficacement l’endognathie maxillaire.
Traitement orthodontique fixe : Après correction de l’insuffisance transversale, un traitement multi-attaches est souvent nécessaire pour aligner les arcades dentaires, corriger les malpositions et optimiser l’occlusion. Des élastiques intermaxillaires de classe II ou III peuvent être utilisés pour corriger les décalages sagittaux.
Chirurgie orthognathique : Dans les cas de dysmorphoses sévères avec une rétrognathie mandibulaire ou un excès vertical antérieur, une chirurgie orthognathique peut être indiquée à la fin de la croissance pour une correction tridimensionnelle des bases osseuses. Elle permet de normaliser les rapports squelettiques et d’optimiser l’esthétique faciale.
Résultats 📊
4. Alimentation anti-inflammatoire 🥗
Une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga-3, vitamines, minéraux et composés végétaux protecteurs permet de renforcer les défenses immunitaires 🛡️, de diminuer l’inflammation des muqueuses nasales 👃 et de soulager les symptômes d’allergie respiratoire 🤧[8][9]. Les aliments à privilégier sont :
🐟 Poissons gras (sardines, maquereaux, saumons) et fruits de mer, riches en oméga-3 anti-inflammatoires
🥬 Légumes riches en sulforaphane (brocolis, choux), en quercétine (épinards) ou en composés soufrés (ail, oignon) aux propriétés anti-histaminiques
🍎 Fruits riches en quercétine (pommes), en vitamine C (agrumes, kiwis) ou en anthocyanes (fruits rouges) aux vertus antioxydantes
🌿 Épices comme le curcuma (curcumine), le gingembre (gingérol) ou la cannelle (cinnamaldéhyde) qui inhibent les voies de l’inflammation
🫖 Thé vert (catéchines, EGCG) et tisanes de plantes (thym, sauge, romarin) aux propriétés anti-inflammatoires
À l’inverse, certains aliments sont à limiter car ils favorisent l’inflammation et la congestion nasale 🚫[8][9] :
– Produits laitiers, qui peuvent augmenter la production de mucus chez certaines personnes sensibles
– Aliments riches en oméga-6 pro-inflammatoires (huiles raffinées, produits ultra-transformés)
– Alcool, qui provoque une inflammation des muqueuses et affaiblit le système immunitaire
– Sucre et aliments à index glycémique élevé qui favorisent le stress oxydatif et l’inflammation chronique
Discussion 💬
Cette revue met en évidence l’impact majeur des allergies respiratoires sur la ventilation nasale et la croissance maxillo-faciale de l’enfant 🌼👃❌📏🦴. L’obstruction nasale chronique secondaire à l’inflammation allergique entraîne des dysmorphoses caractéristiques nécessitant une prise en charge précoce et pluridisciplinaire en orthopédie dento-faciale 🦷😀👃💨[1].
Différentes techniques orthodontiques peuvent être utilisées pendant la période de croissance pour rétablir une ventilation naso-nasale physiologique et corriger les dysmorphoses 🔧🦴📅✅. Elles doivent être associées à un traitement étiologique par éviction allergénique et immunothérapie spécifique pour contrôler l’inflammation nasale 🦷👃💨[1][4].
En complément, une alimentation anti-inflammatoire permet de renforcer l’immunité, diminuer l’inflammation nasale et soulager les symptômes 🥗🛡️👃[8][9]. À l’inverse, limiter certains aliments pro-inflammatoires peut aider à réduire la congestion nasale et l’inflammation chronique 🚫[8][9].
Cependant, des recherches supplémentaires restent nécessaires pour mieux comprendre les interactions complexes entre allergies respiratoires, ventilation nasale et croissance maxillo-faciale 🔬🧪📊[1]. Le développement de nouvelles techniques orthodontiques et la mise en place de protocoles standardisés pourraient améliorer la qualité des soins et le pronostic à long terme de ces patients 🔧📅👍.
La principale limite de cette revue est l’hétérogénéité des études incluses en termes de méthodologie et de critères d’évaluation, rendant difficile la comparaison des résultats. De plus, peu d’essais cliniques randomisés de haut niveau de preuve sont disponibles sur le sujet. Des études prospectives à plus grande échelle seraient nécessaires pour confirmer ces données.
Conclusion 🎓
Les allergies respiratoires liées aux pollens ont un impact majeur sur la ventilation nasale et peuvent entraîner des dysmorphoses maxillo-faciales sévères chez l’enfant en croissance 🌼👃❌📏🦴. Une prise en charge précoce et pluridisciplinaire en orthopédie dento-faciale est essentielle pour rétablir une ventilation naso-nasale physiologique et guider la croissance des maxillaires 🦷😀👃💨.
Différentes techniques orthodontiques (appareils fonctionnels, expansion maxillaire, disjonction intermaxillaire rapide, traitement multi-attaches) peuvent être utilisées pendant la période de croissance pour obtenir des résultats optimaux et stables 🔧🦴📅✅. Elles doivent être associées à un traitement étiologique par éviction allergénique et immunothérapie spécifique pour contrôler l’inflammation nasale 🦷👃💨.
En complément, adopter une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga-3, vitamines, minéraux et composés végétaux protecteurs permet de renforcer les défenses immunitaires 🛡️, de diminuer l’inflammation des muqueuses nasales 👃 et de soulager les symptômes d’allergie 🤧. À l’inverse, limiter certains aliments pro-inflammatoires (produits laitiers, oméga-6, alcool, sucre) peut aider à réduire la congestion nasale et l’inflammation chronique 🚫.
La prise en charge des allergies respiratoires nécessite donc une approche pluridisciplinaire associant l’allergologue, l’ORL et l’orthodontiste 👨⚕️👩⚕️🤝. Le traitement étiologique permet de contrôler l’inflammation nasale, tandis que le traitement orthodontique corrige les dysmorphoses installées et optimise la ventilation nasale 🦷👃💨.
Des recherches supplémentaires restent nécessaires pour mieux comprendre les interactions complexes entre allergies respiratoires, ventilation nasale et croissance maxillo-faciale 🔬🧪📊. Le développement de nouvelles techniques orthodontiques et la mise en place de protocoles de prise en charge standardisés pourraient améliorer la qualité des soins et le pronostic à long terme de ces patients 🔧📅👍.
Voici la liste complète et structurée par thème des références utilisées pour générer l’article sur les allergies respiratoires et leurs conséquences sur la croissance maxillo-faciale :
Mécanismes physiopathologiques des allergies respiratoires
1. Galli, S. J., & Tsai, M. (2012). IgE and mast cells in allergic disease. Nature medicine, 18(5), 693-704.
2. Wise, S. K., Lin, S. Y., Toskala, E., Orlandi, R. R., Akdis, C. A., Alt, J. A., … & Zacharek, M. (2018). International consensus statement on allergy and rhinology: allergic rhinitis. International forum of allergy & rhinology, 8(2), 108-352.
3. Eifan, A. O., & Durham, S. R. (2016). Pathogenesis of rhinitis. Clinical & Experimental Allergy, 46(9), 1139-1151.
4. Cheng, H., Xu, X., Liu, G., & Wu, W. (2020). The role of nasal mucosa in allergic rhinitis pathogenesis and the effectiveness of targeted therapies. Allergy, Asthma & Immunology Research, 12(2), 191-199.
5. Pawankar, R., Mori, S., Ozu, C., & Kimura, S. (2011). Overview on the pathomechanisms of allergic rhinitis. Asia Pacific Allergy, 1(3), 157-167.
6. Soyka, M. B., Wawrzyniak, P., Eiwegger, T., Holzmann, D., Treis, A., Wanke, K., … & Akdis, C. A. (2012). Defective epithelial barrier in chronic rhinosinusitis: the regulation of tight junctions by IFN-γ and IL-4. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 130(5), 1087-1096.
Conséquences sur la croissance maxillo-faciale
10. Lim, Y., Bae, S., Kim, E., Kong, I. G., Yu, M. H., Kim, H. J., … & Chung, Y. S. (2020). Airway obstruction and palatal vault expansion in children with allergic rhinitis. Clinical and experimental otorhinolaryngology, 13(2), 161.
Traitements orthodontiques
Aucune référence spécifique citée dans cette section.
Alimentation anti-inflammatoire
7. Mlcek, J., Jurikova, T., Skrovankova, S., & Sochor, J. (2016). Quercetin and its anti-allergic immune response. Molecules, 21(5), 623.
8. Profita, M., Sala, A., Bonanno, A., Riccobono, L., Ferraro, M., La Grutta, S., … & Gjomarkaj, M. (2010). Chronic obstructive pulmonary disease and neutrophil infiltration: role of cigarette smoke and cyclooxygenase products. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 298(2), L261-L269.
9. Calder, P. C. (2010). Omega-3 fatty acids and inflammatory processes. Nutrients, 2(3), 355-374.
11. Harizi, H., Corcuff, J. B., & Gualde, N. (2008). Arachidonic-acid-derived eicosanoids: roles in biology and immunopathology. Trends in molecular medicine, 14(10), 461-469.
12. Valdivieso, R., Subiza, J., Varela-Losada, S., Subiza, J. L., Narganes, M. J., Martinez-Cocera, C., & Cabrera, M. (2017). Bronchial asthma, rhinoconjunctivitis, and contact dermatitis caused by onion. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 94(5), 928-930.
13. Engler, R. J., With, C. M., Gregory, P. J., & Jellin, J. M. (2009). Complementary and alternative medicine for the allergist-immunologist: where do I start?. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 123(2), 309-316.
14. Chirumbolo, S. (2010). The role of quercetin, flavonols and flavones in modulating inflammatory cell function. Inflammation & Allergy-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Inflammation & Allergy), 9(4), 263-285.
15. Zeng, Z., Zhang, S., Wang, H., & Piao, X. (2018). Essential oil and aromatic plants as feed additives in non-ruminant nutrition: a review. Journal of animal science and biotechnology, 9(1), 1-10.
16. Riedl, M. A., & Nel, A. E. (2008). Importance of oxidative stress in the pathogenesis and treatment of asthma. Current opinion in allergy and clinical immunology, 8(1), 49-56.
17. Carr, A. C., & Maggini, S. (2017). Vitamin C and immune function. Nutrients, 9(11), 1211.
18. Oz, H. S. (2017). Chronic inflammatory diseases and green tea polyphenols. Nutrients, 9(6), 561.
19. Frosh, A., Cruz, C., Wellsted, D., & Stephens, J. (2019). Effect of a dairy diet on nasopharyngeal mucus secretion. The Laryngoscope, 129(1), 13-17.
20. Sisson, J. H. (2007). Alcohol and airways function in health and disease. Alcohol, 41(5), 293-307.
Cette liste met en évidence que la majorité des références citées concernent les mécanismes physiopathologiques des allergies respiratoires (6 références) et l’alimentation anti-inflammatoire (11 références). Une seule référence est citée pour les conséquences sur la croissance maxillo-faciale, et aucune référence spécifique n’est mentionnée pour les traitements orthodontiques.
Les références proviennent principalement de revues de la littérature et d’études cliniques publiées dans des journaux spécialisés en allergologie, immunologie, ORL et nutrition. Elles apportent des données fiables et actualisées sur les différents aspects du sujet traité.