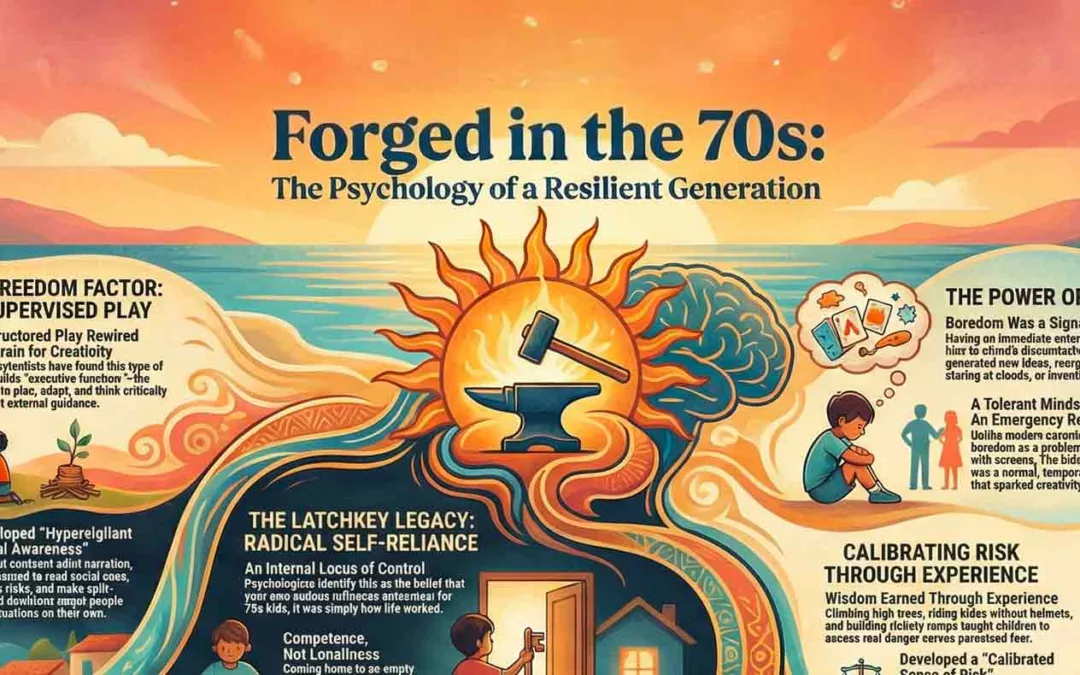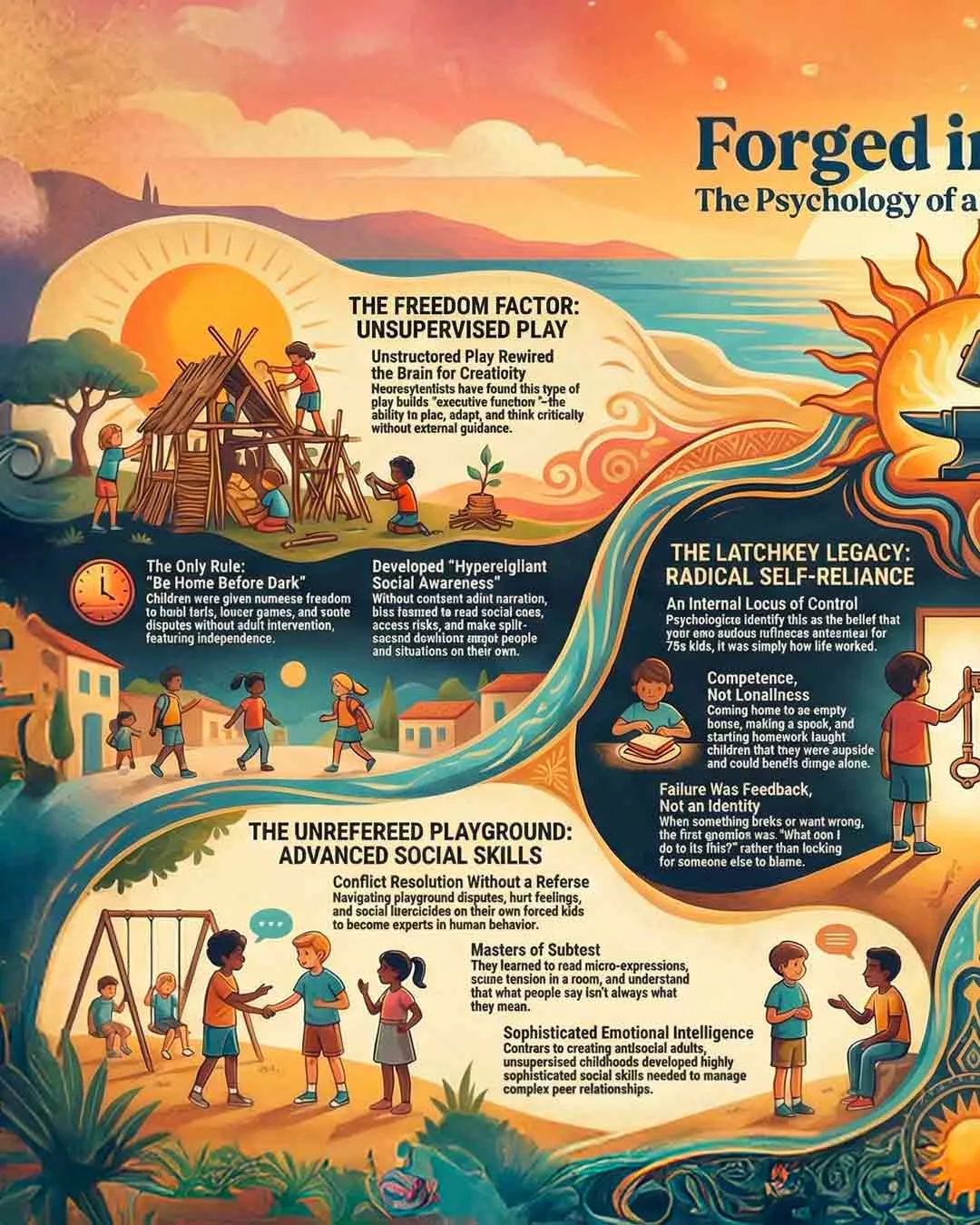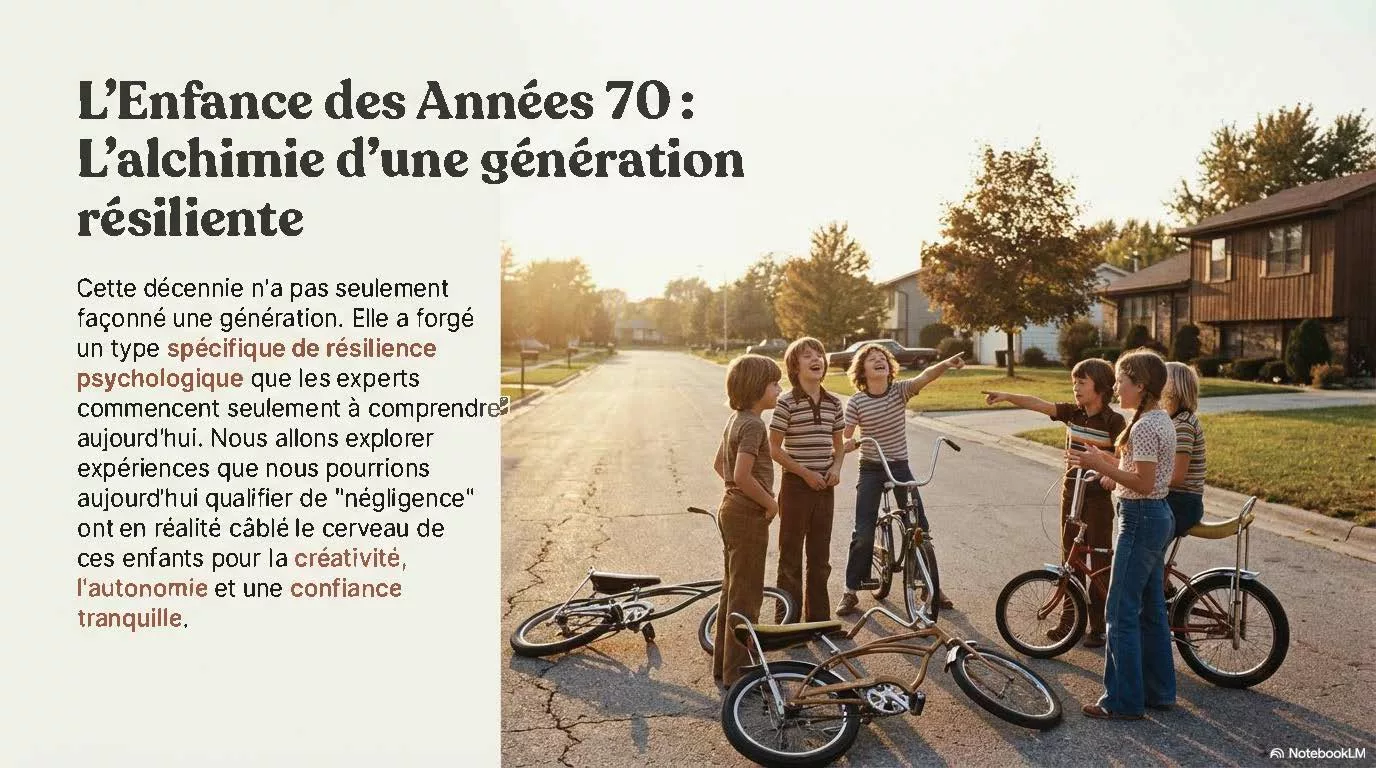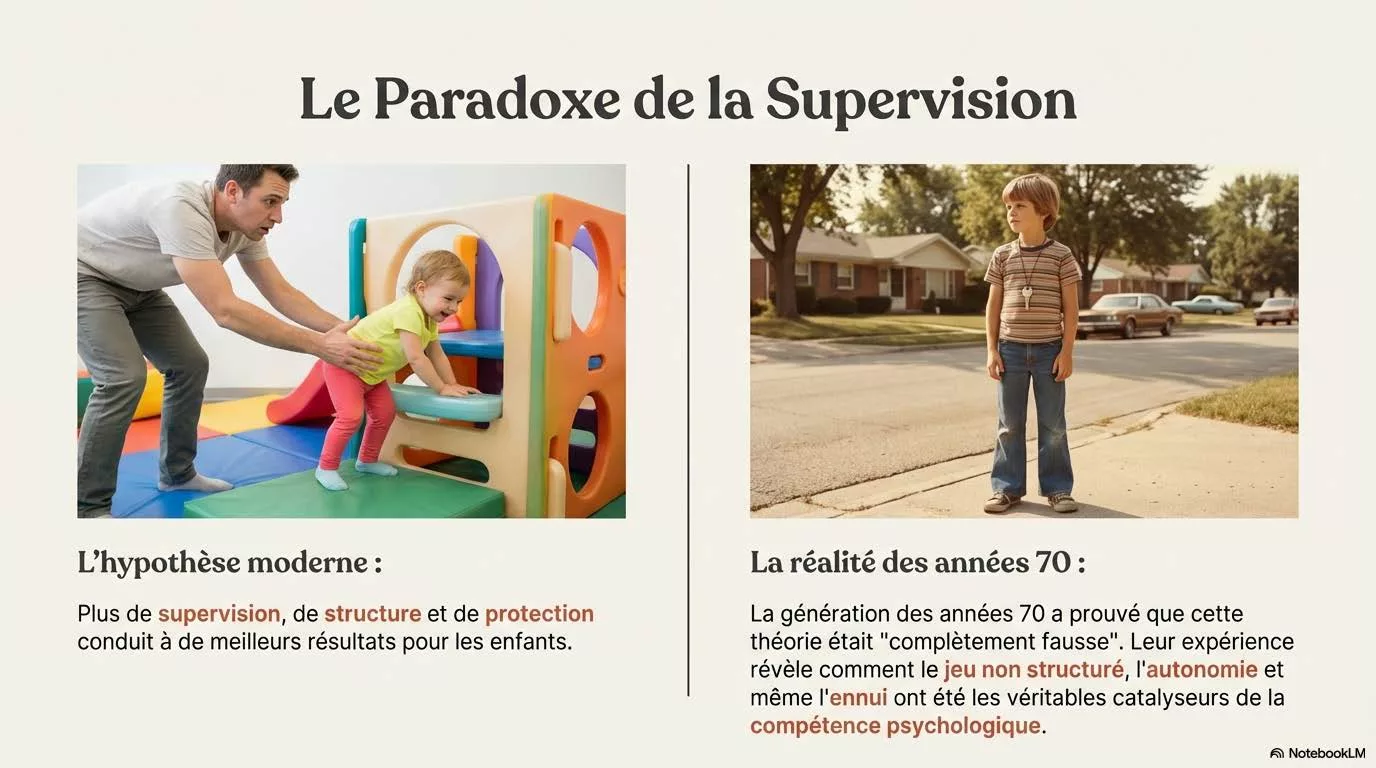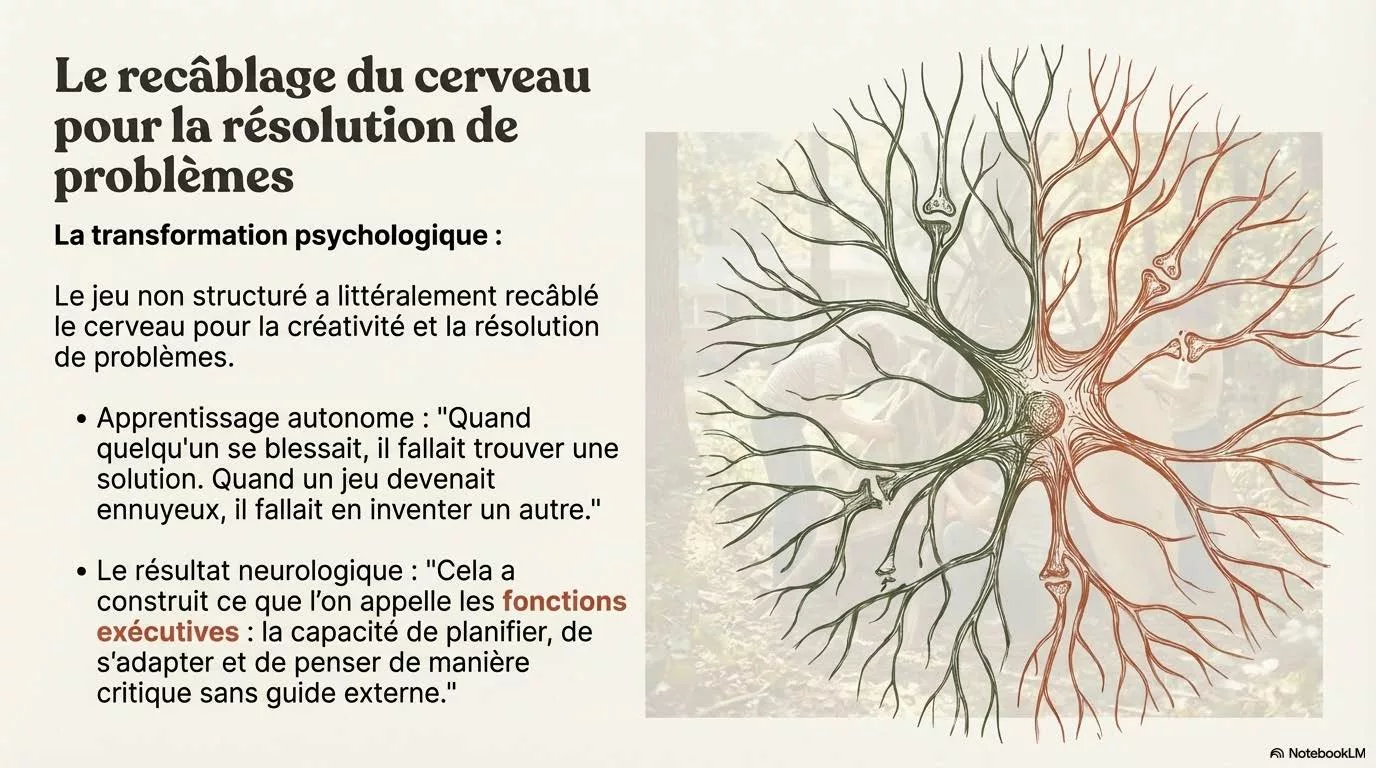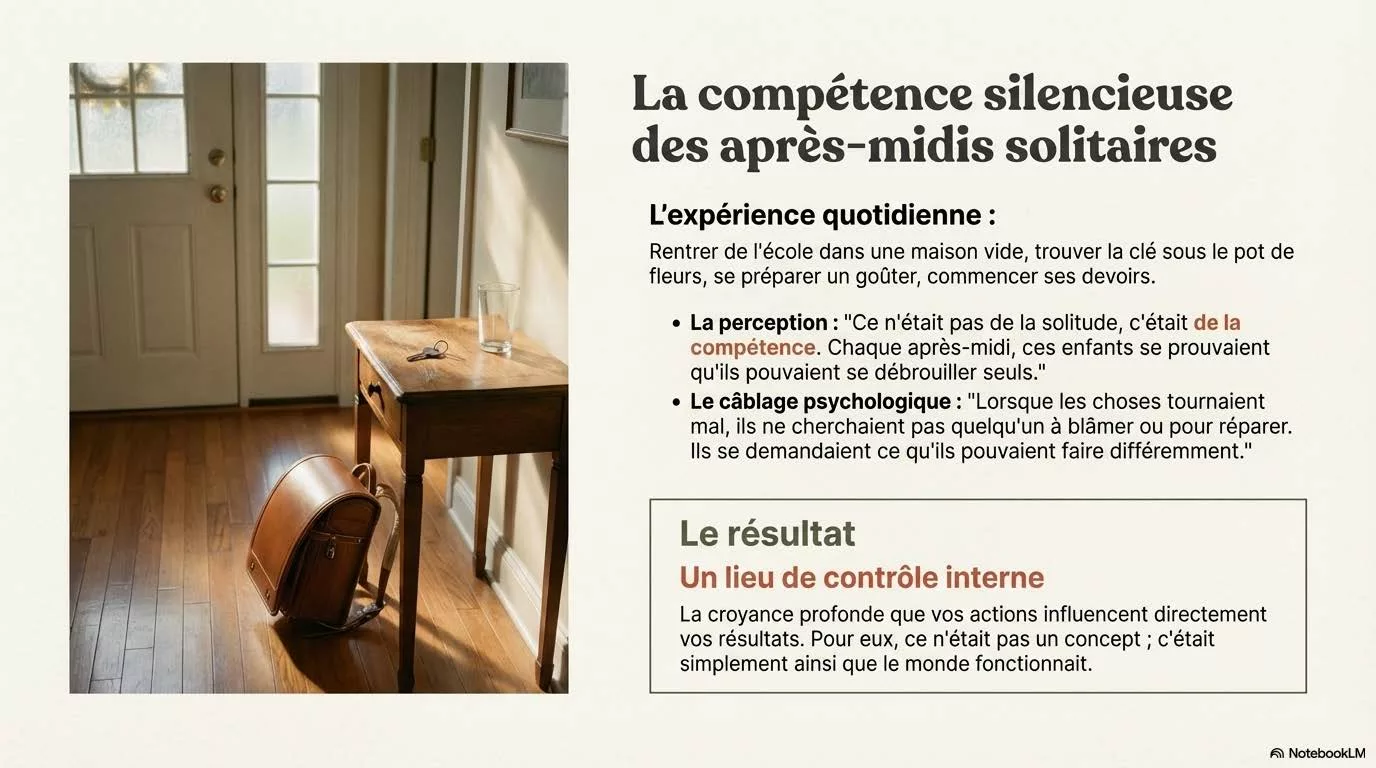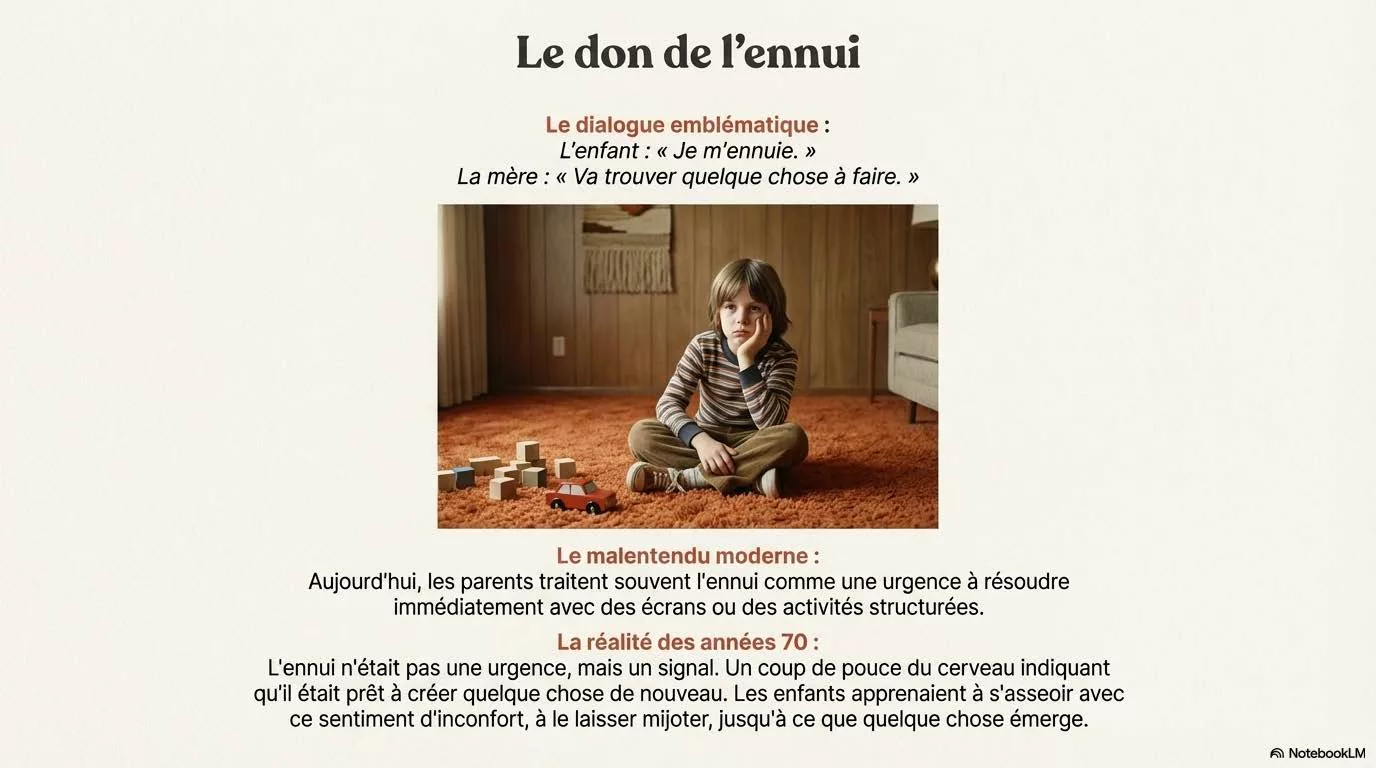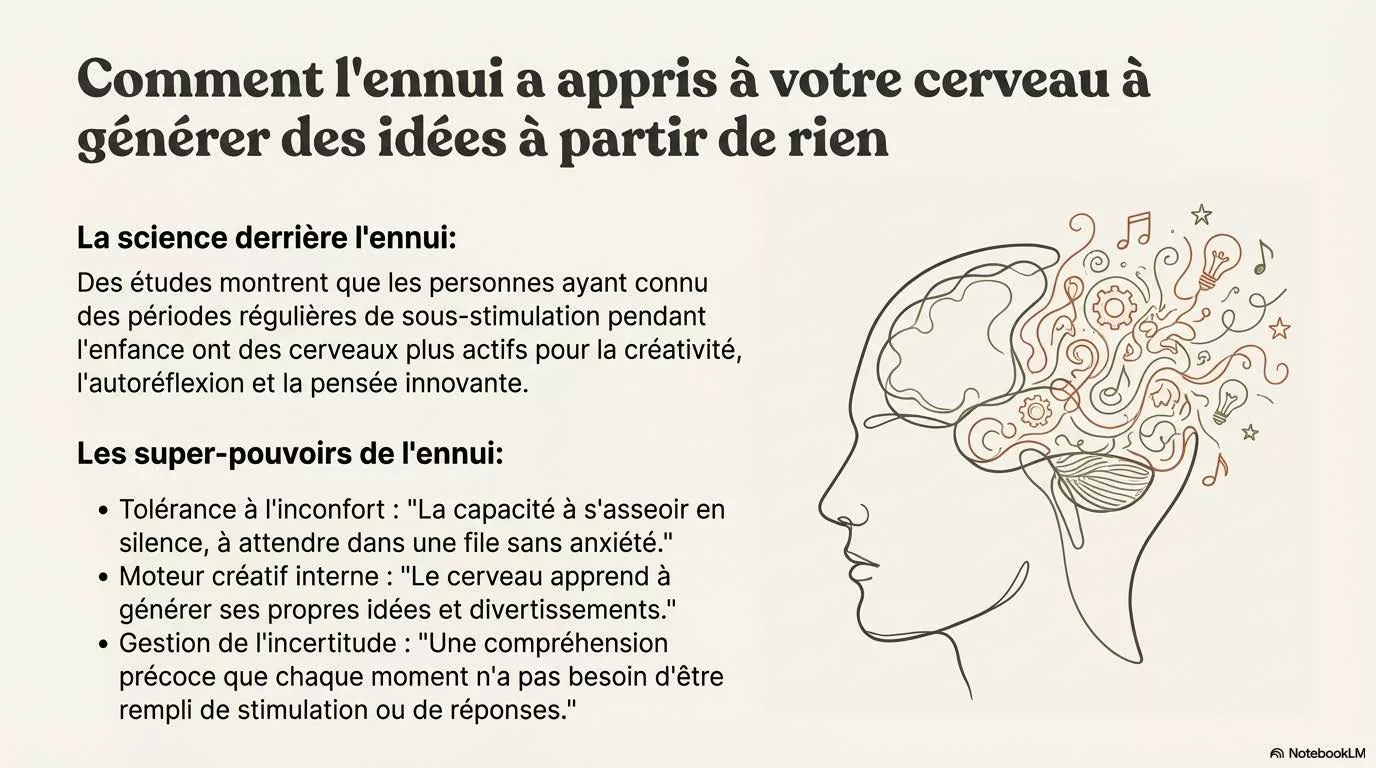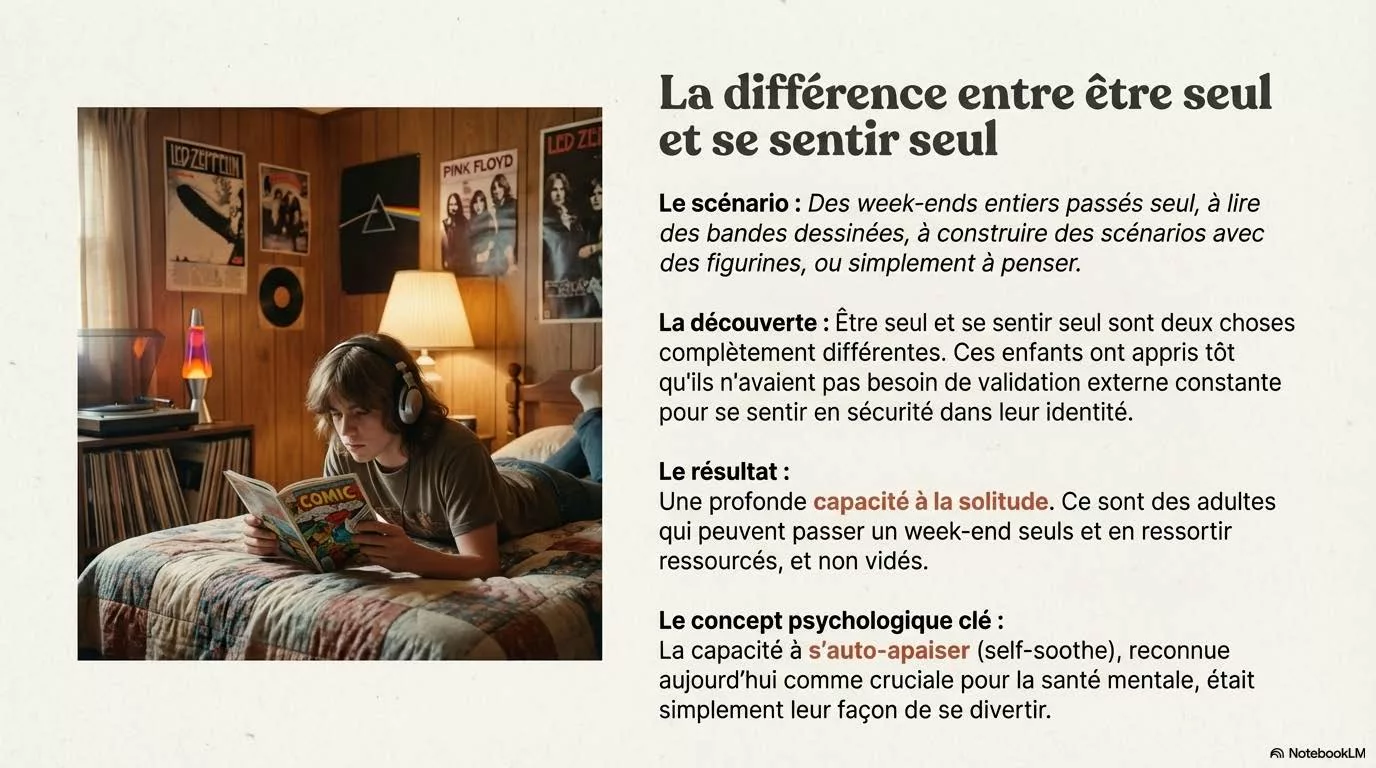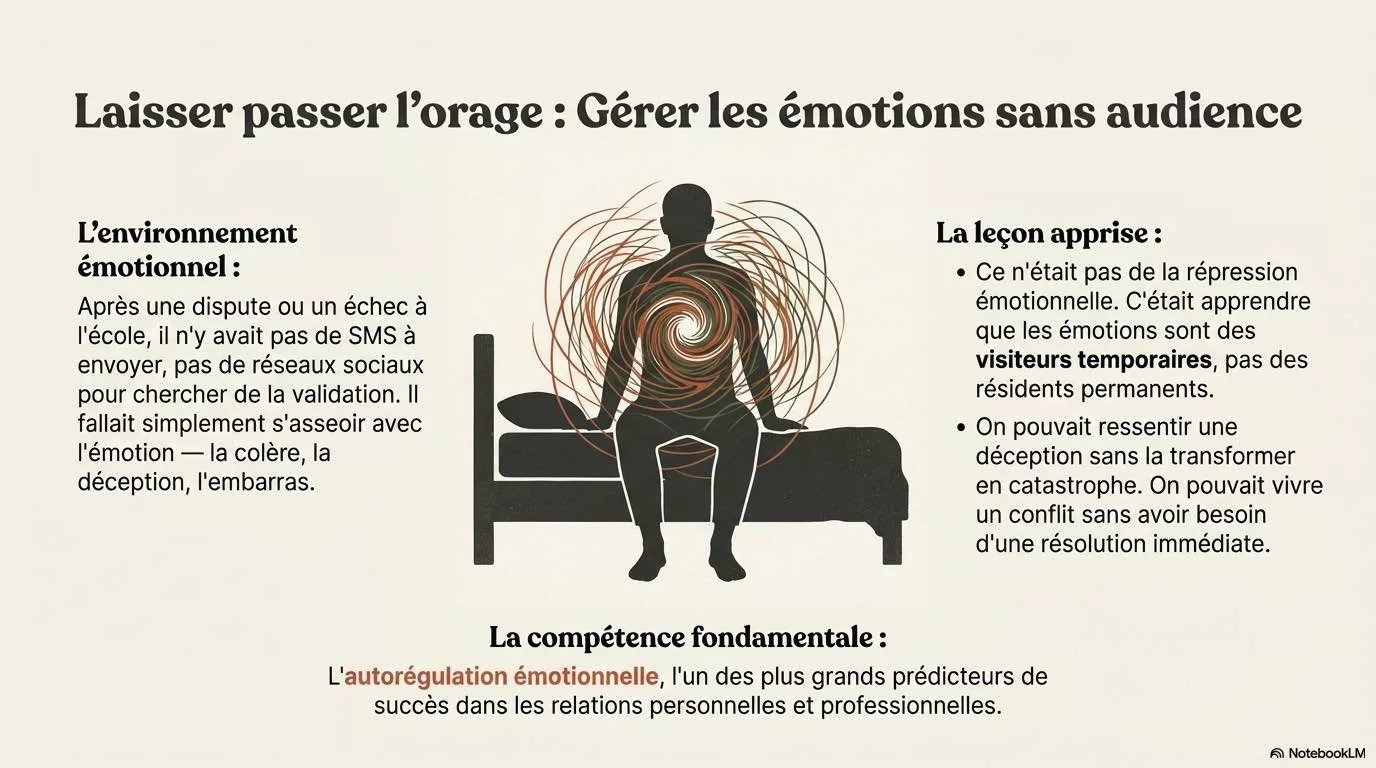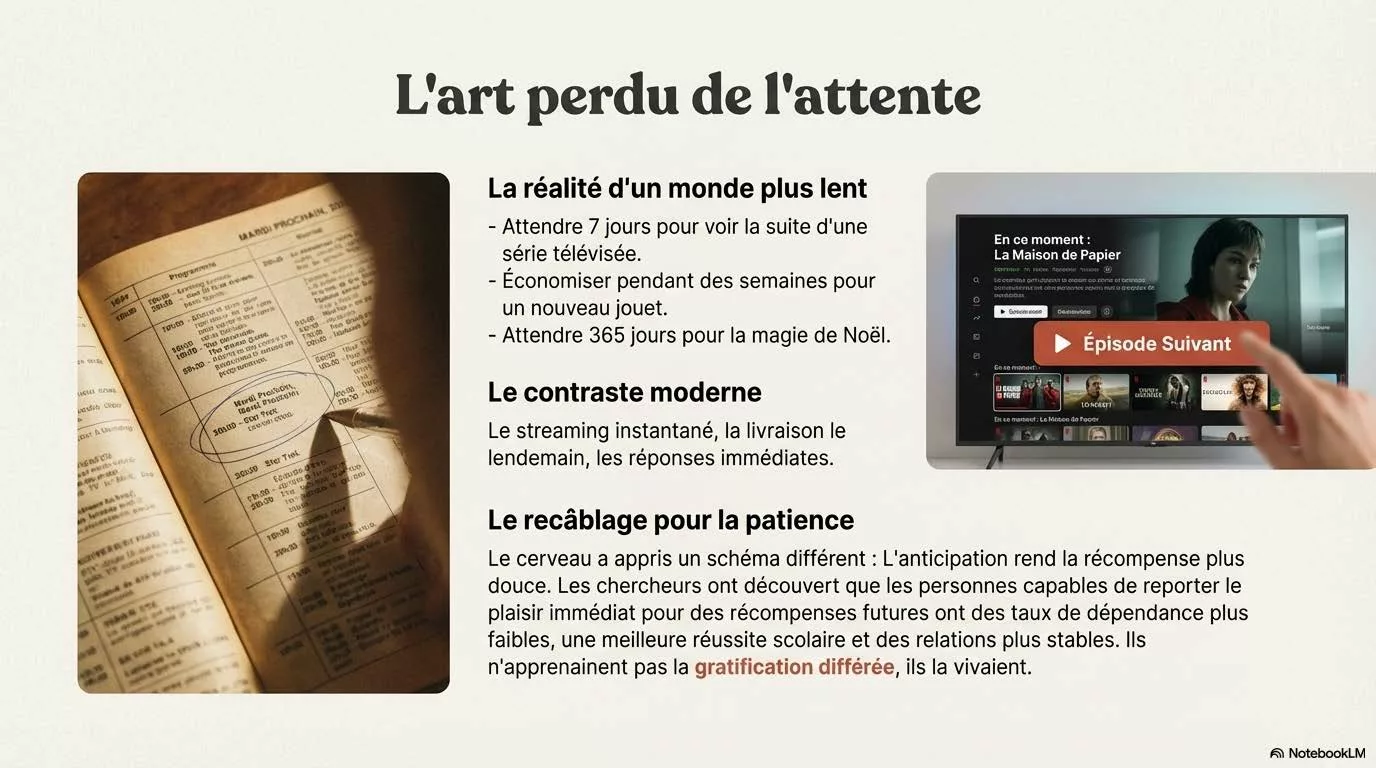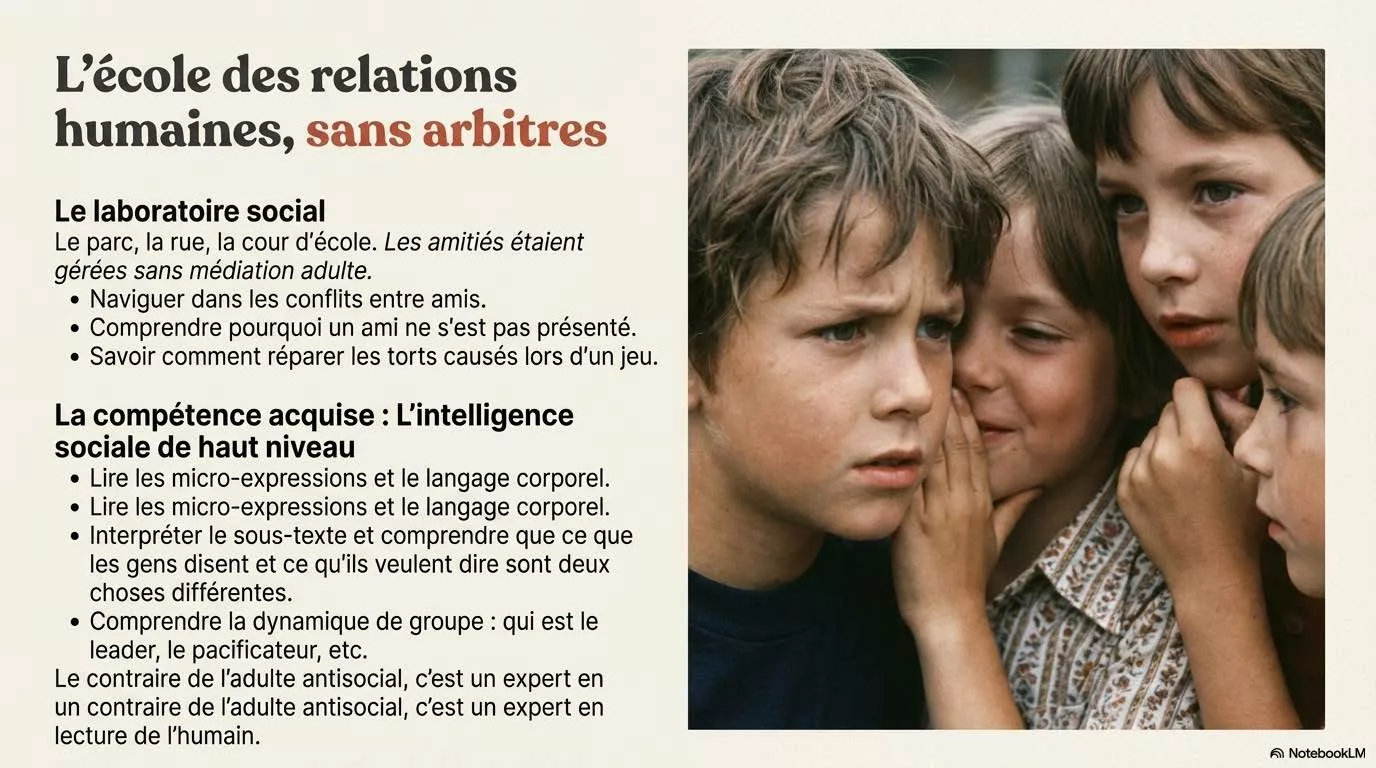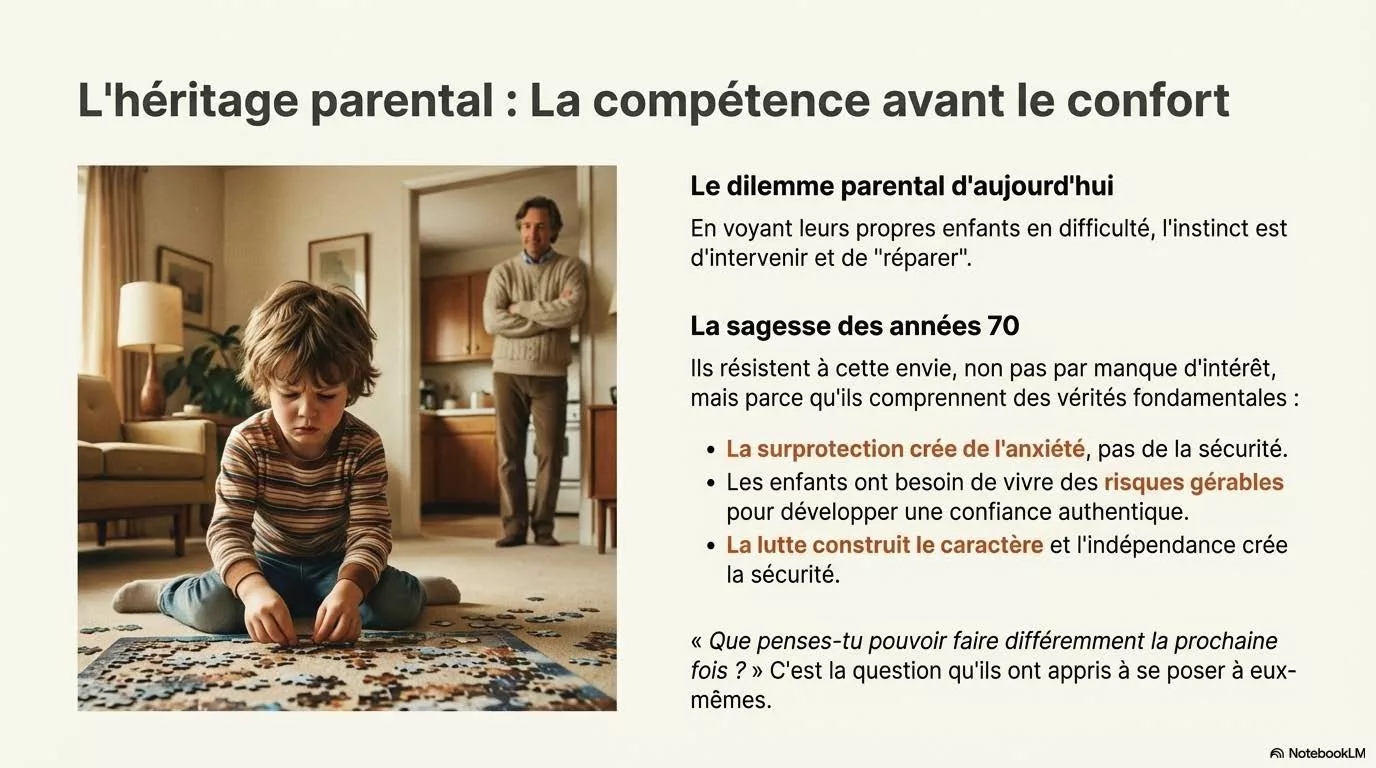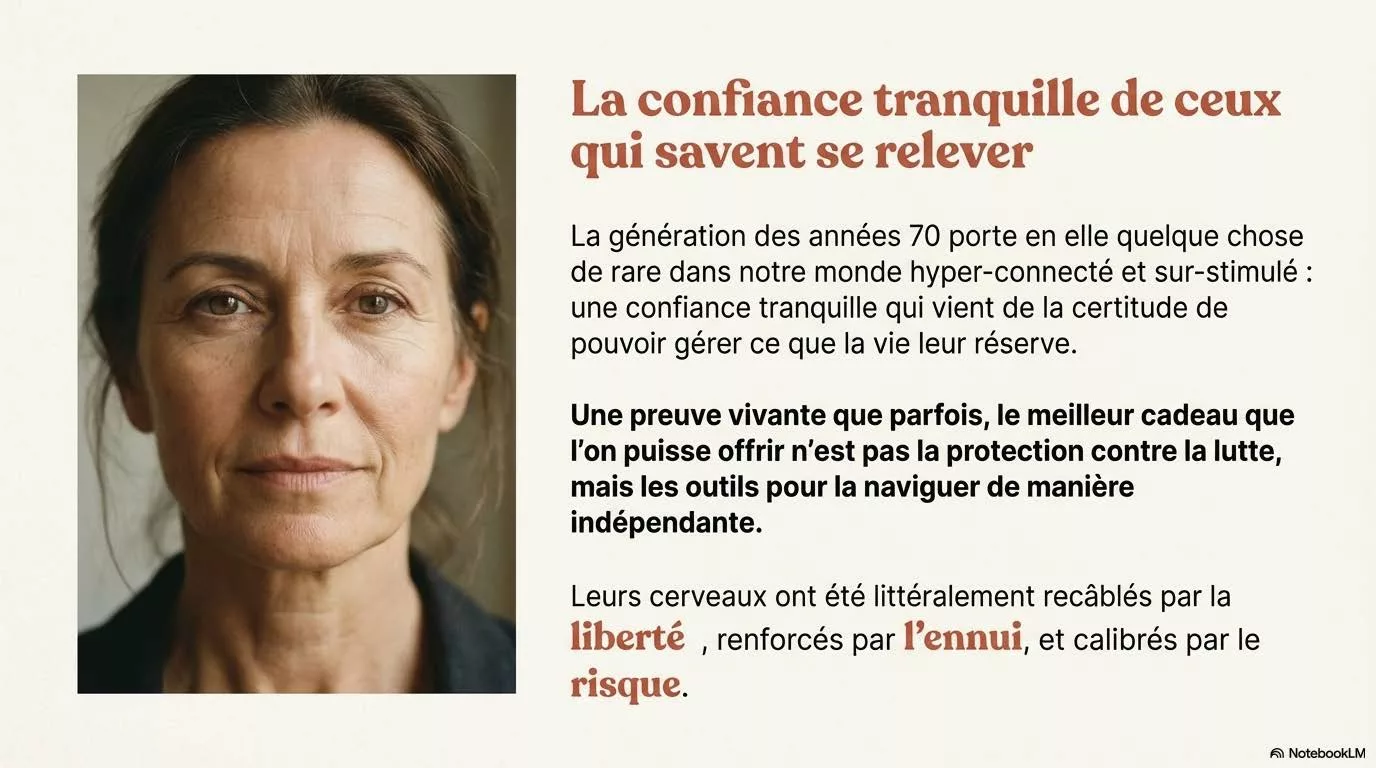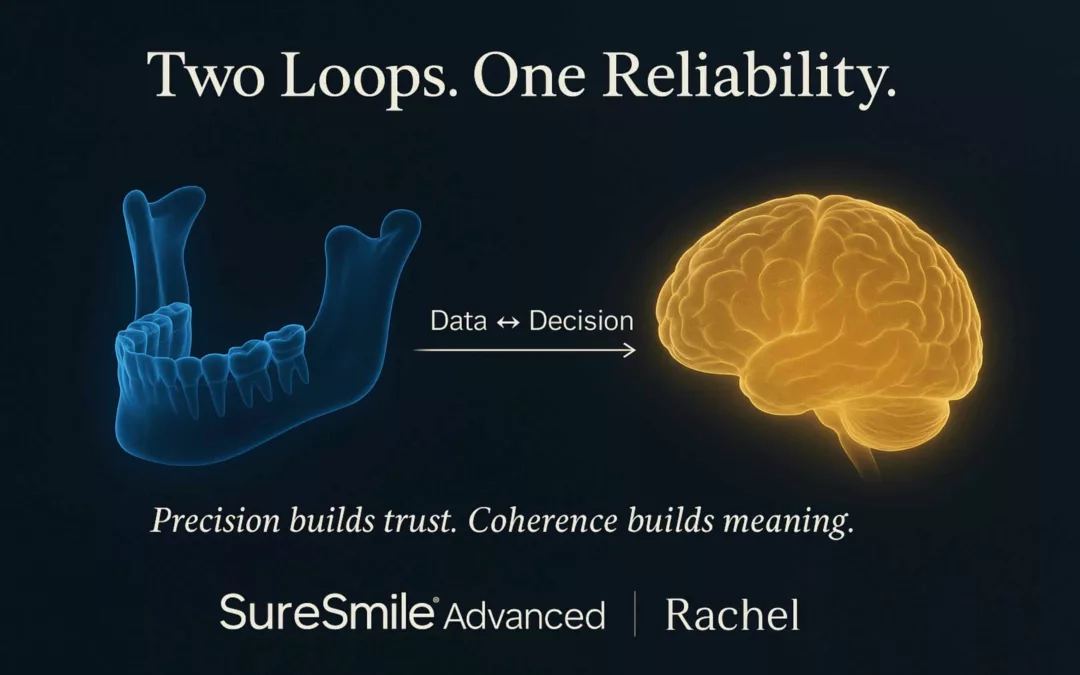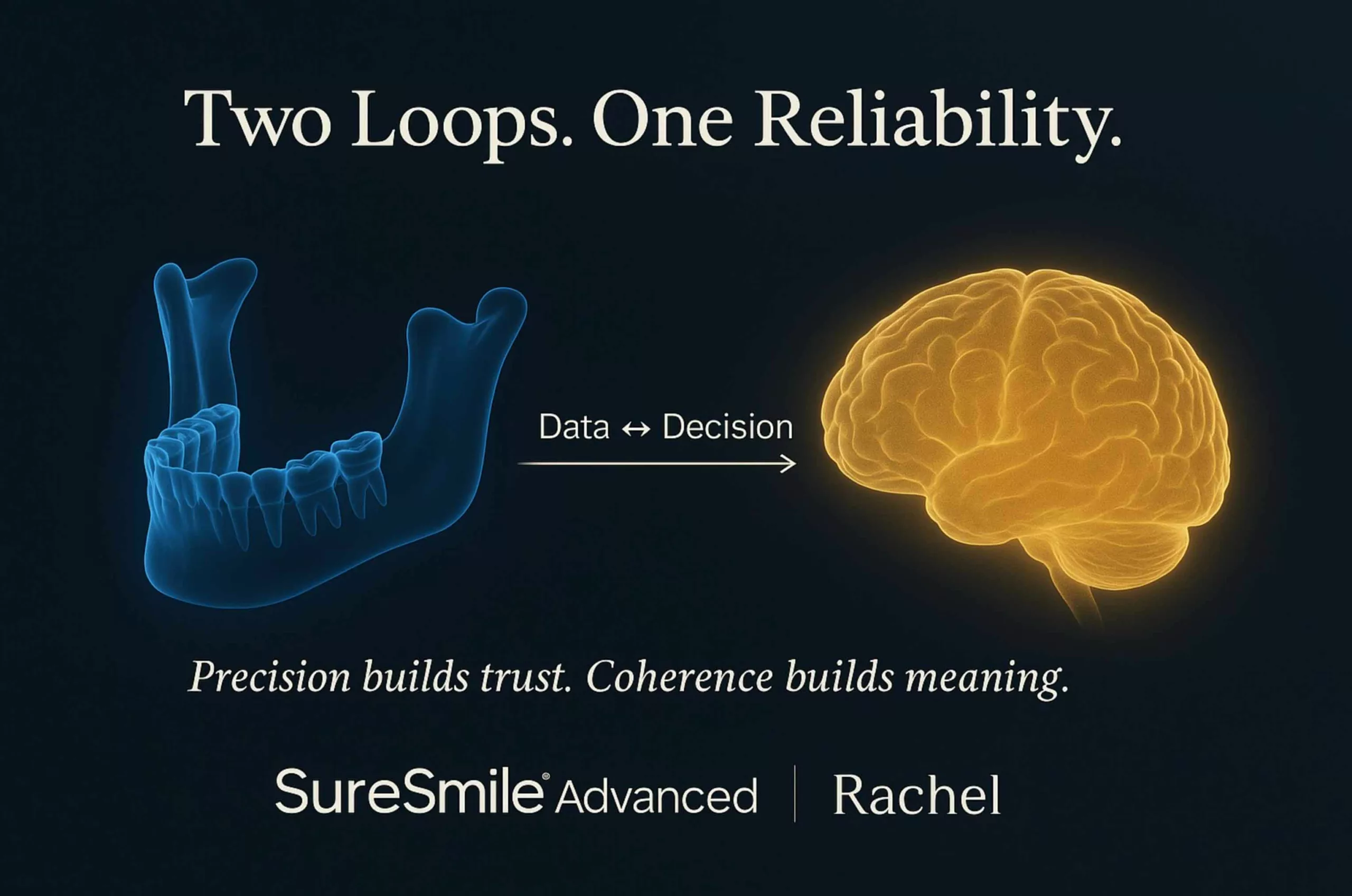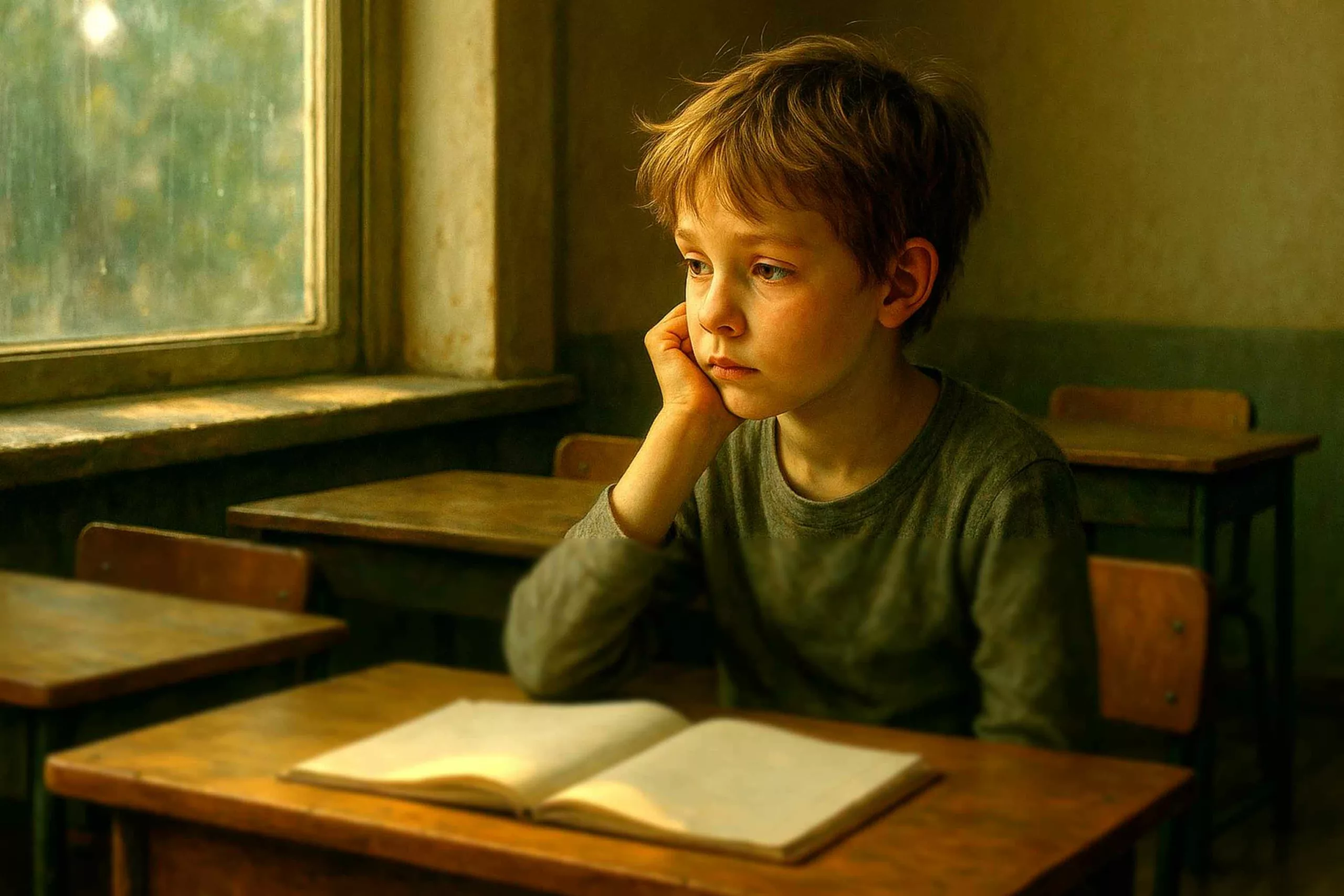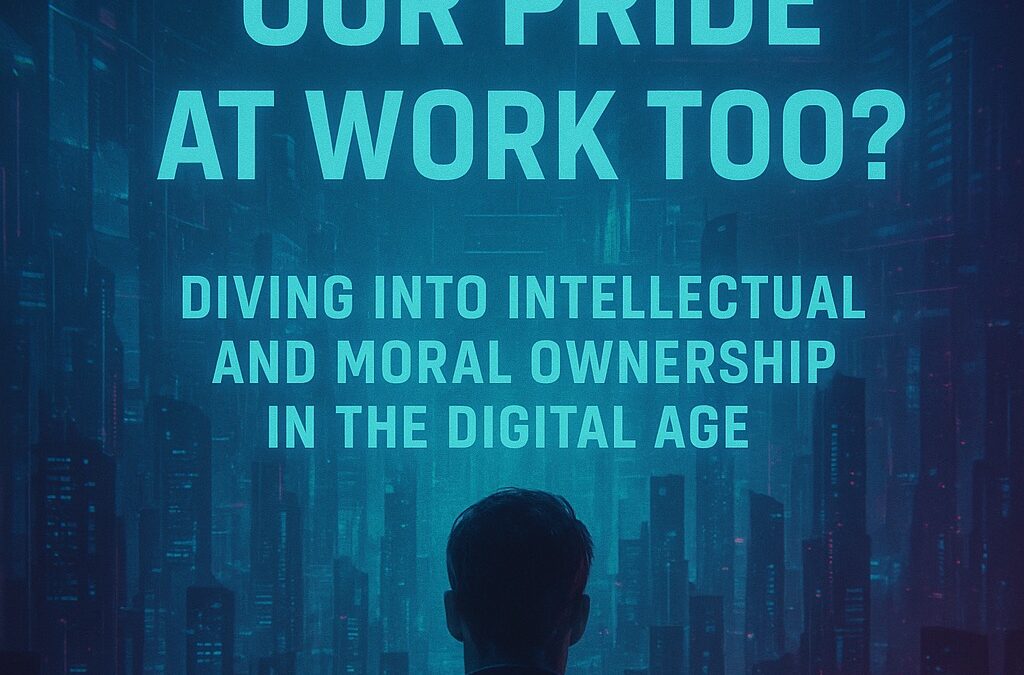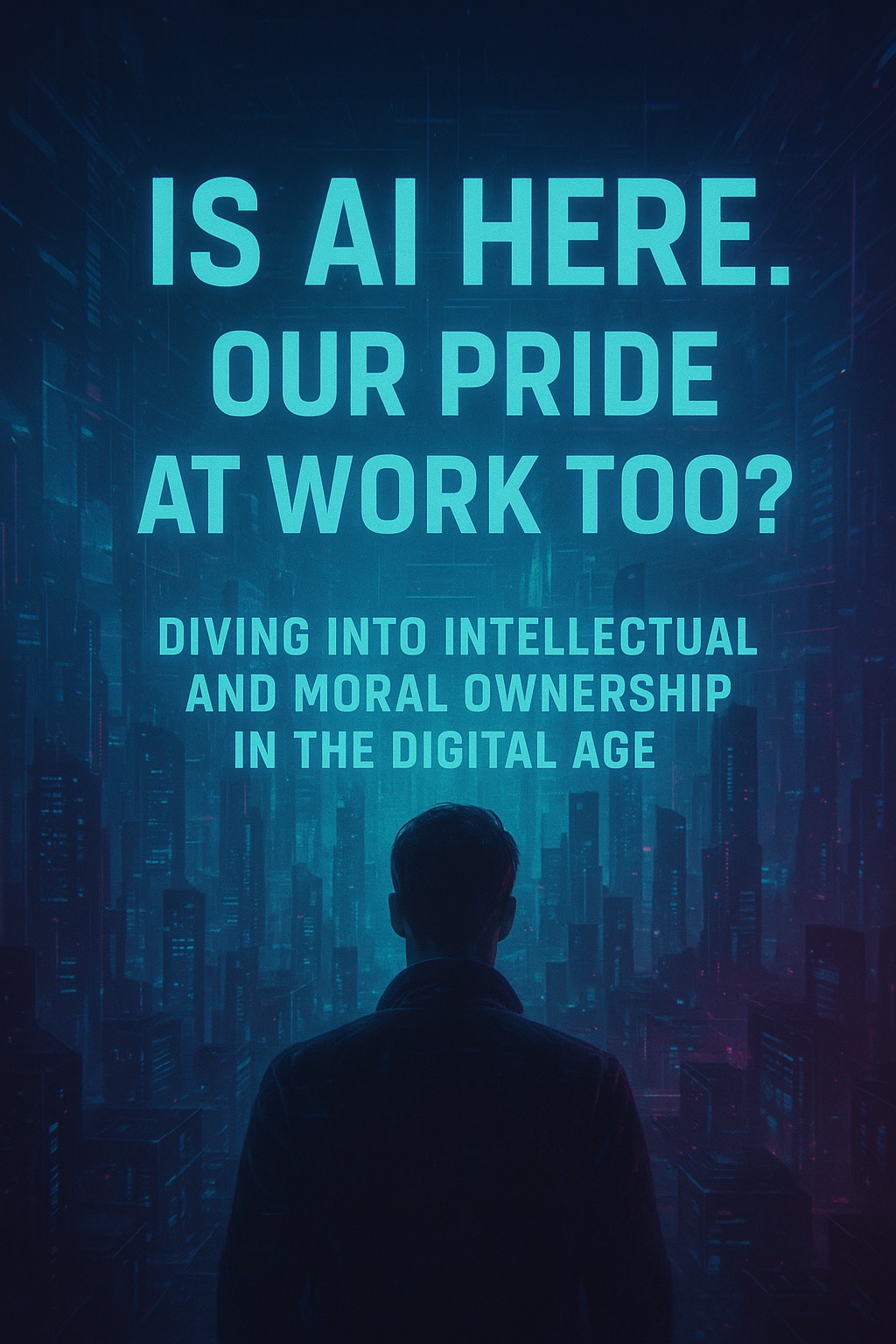Chez l’enfant
Le profil sans hyperactivité :
• Semble écouter en classe mais n’entend rien
• Oublie les consignes immédiatement après les avoir entendues
• Perd régulièrement ses affaires
• Commence plusieurs devoirs sans en finir aucun
• Résultats scolaires en « dents de scie » : brillant sur un exercice, catastrophique sur le suivant
• Bulletin type : « élève capable mais ne travaille pas », « dans la lune », « manque de concentration »
Le profil avec hyperactivité :
• Se lève constamment en classe
• Bavarde de façon incessante
• Joue avec ses crayons, ses vêtements, tout ce qui tombe sous la main
• Interrompt systématiquement
• Pose des questions sans écouter les réponses
• Bulletin type : « perturbe la classe », « n’écoute pas les consignes », « agitation permanente »
Le cas de l’enfant brillant : un diagnostic retardé
Un phénomène critique : l’enfant à haut potentiel intellectuel avec TDAH.
Ses capacités cognitives exceptionnelles compensent le trouble pendant des années. Il obtient de bonnes, voire d’excellentes notes jusqu’en primaire, parfois jusqu’au collège. Puis, soudainement, l’effondrement : le volume de travail augmente, la complexité s’accroît, les capacités de compensation atteignent leurs limites.
Rétrospectivement, en relisant les anciens bulletins, les signes étaient là : « pourrait mieux faire », « bavarde », « distrait », « travail bâclé ». Mais comme les notes restaient correctes, personne ne s’est inquiété.
Chez l’adulte : un handicap invisible
L’adulte TDAH non diagnostiqué vit souvent un enfer quotidien :
Au travail :
• Procrastination massive : reporter indéfiniment les tâches fastidieuses
• Travail au dernier moment, dans l’urgence absolue (seule condition qui force la concentration)
• 4 heures pour accomplir une tâche d’une heure
• Oublis de rendez-vous, confusion dans les dates
• Difficultés avec les rapports écrits, les tâches administratives
• Sensation d’épuisement permanent
• Impression frustrante de ne jamais être à la hauteur de son potentiel
Dans la vie quotidienne :
• Désorganisation chronique
• Perte constante d’objets (clés, téléphone, papiers)
• Difficultés avec les tâches ménagères séquentielles (lessive : laver, étendre, sécher, plier, ranger = 5 étapes = épuisement)
• Multiplication des listes « pour ne rien oublier »
• Relations sociales compliquées par l’impulsivité verbale (« gaffes » fréquentes)
Manifestations physiques discrètes :
Contrairement à l’enfant qui se lève et court partout, l’adulte TDAH présente une agitation subtile :
• Changements incessants de position assise
• Jambe qui croise et décroise continuellement
• Tapotements nerveux
• Difficulté à tenir 3 heures dans une réunion
Certains adultes développent des stratégies compensatoires remarquables : carnets ultra-détaillés, alarmes multiples, systèmes d’organisation sophistiqués. Ils contrôlent ainsi leur TDAH, mais au prix d’une vigilance permanente épuisante.